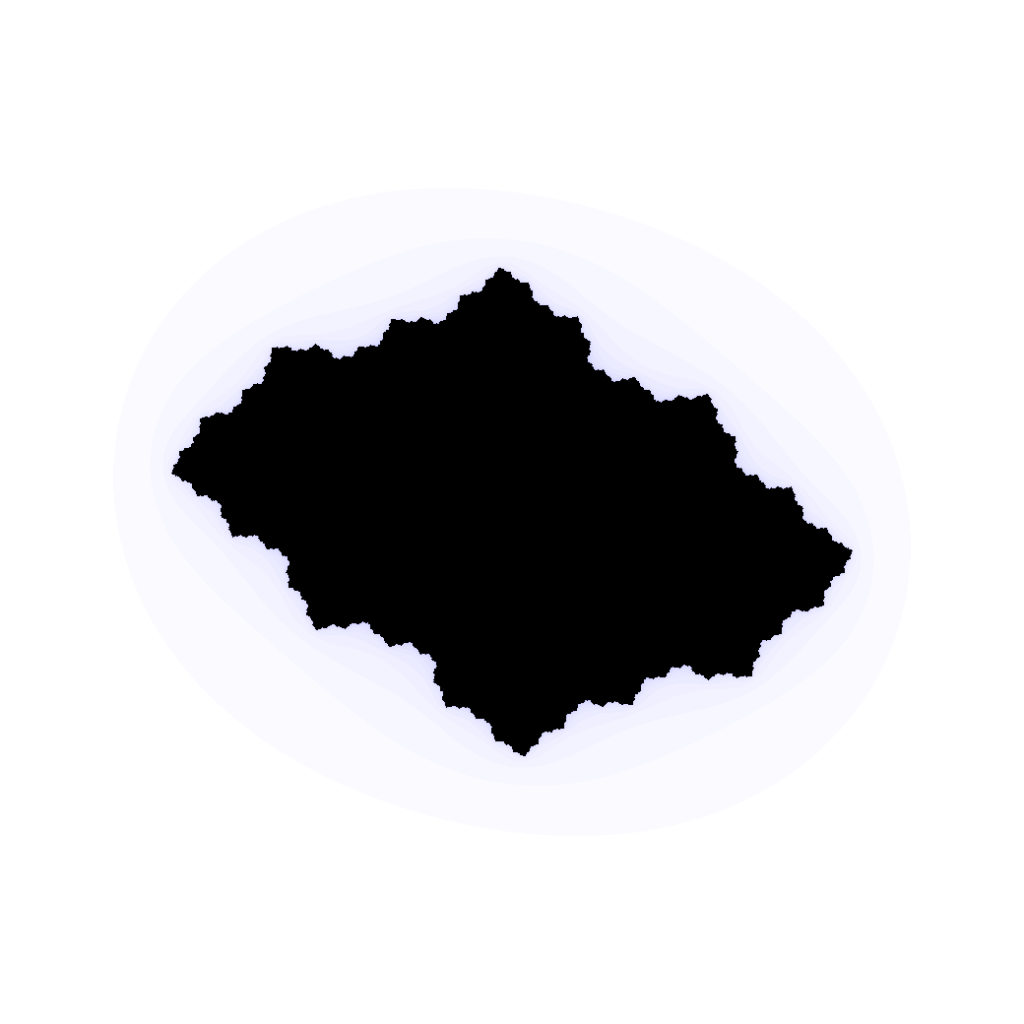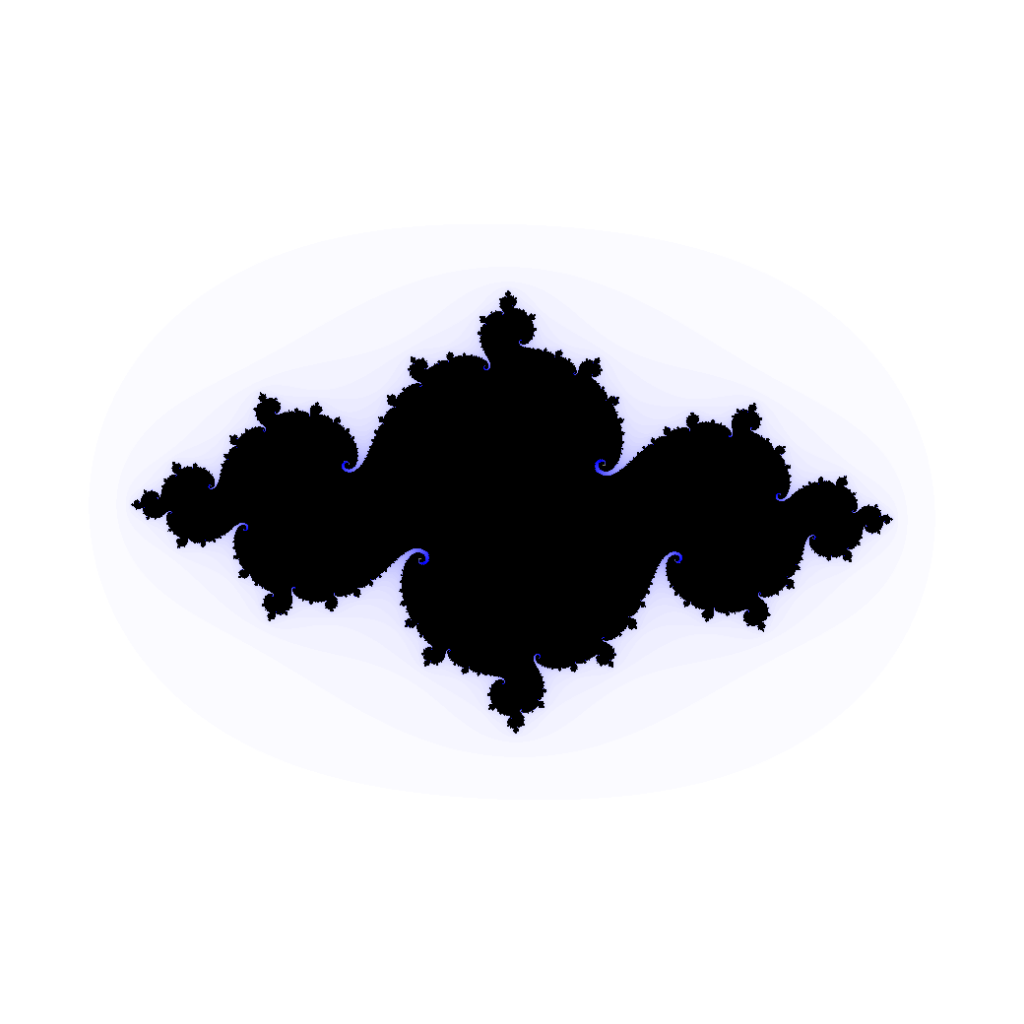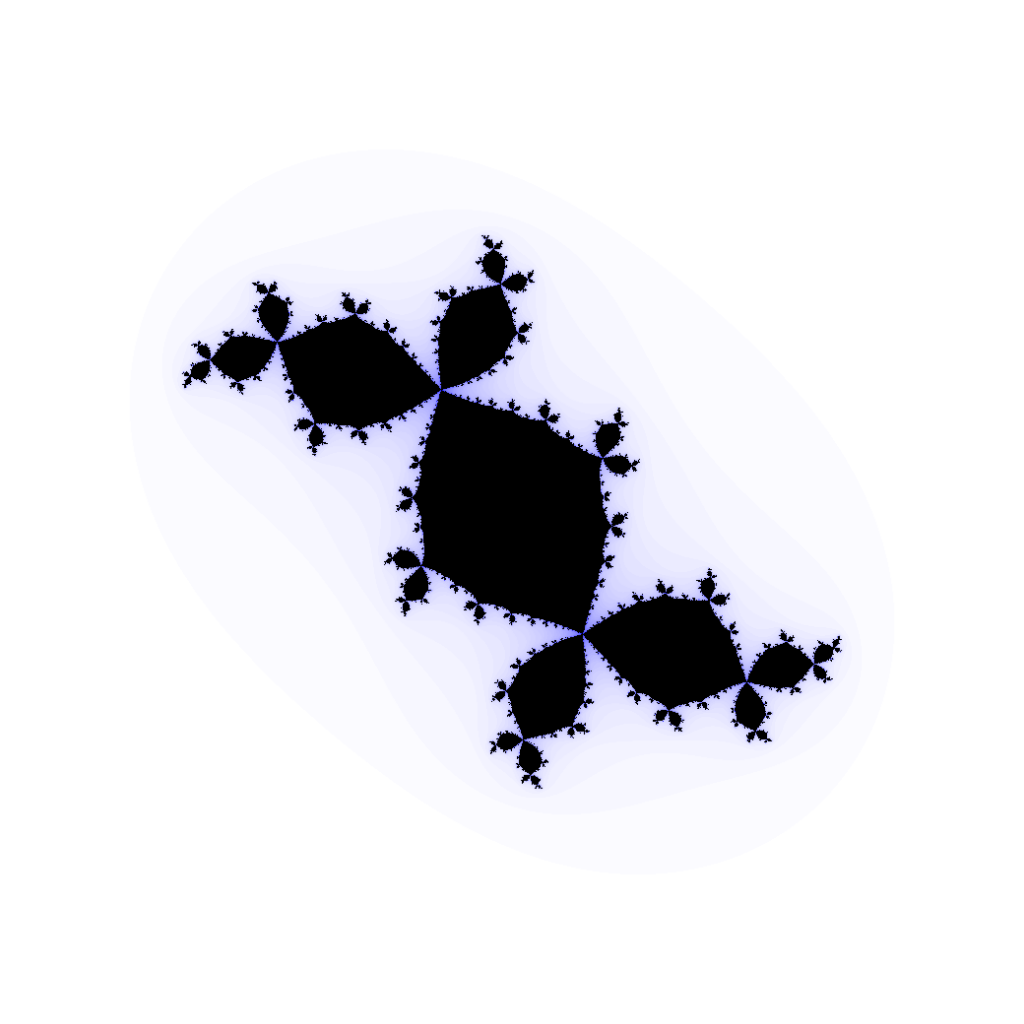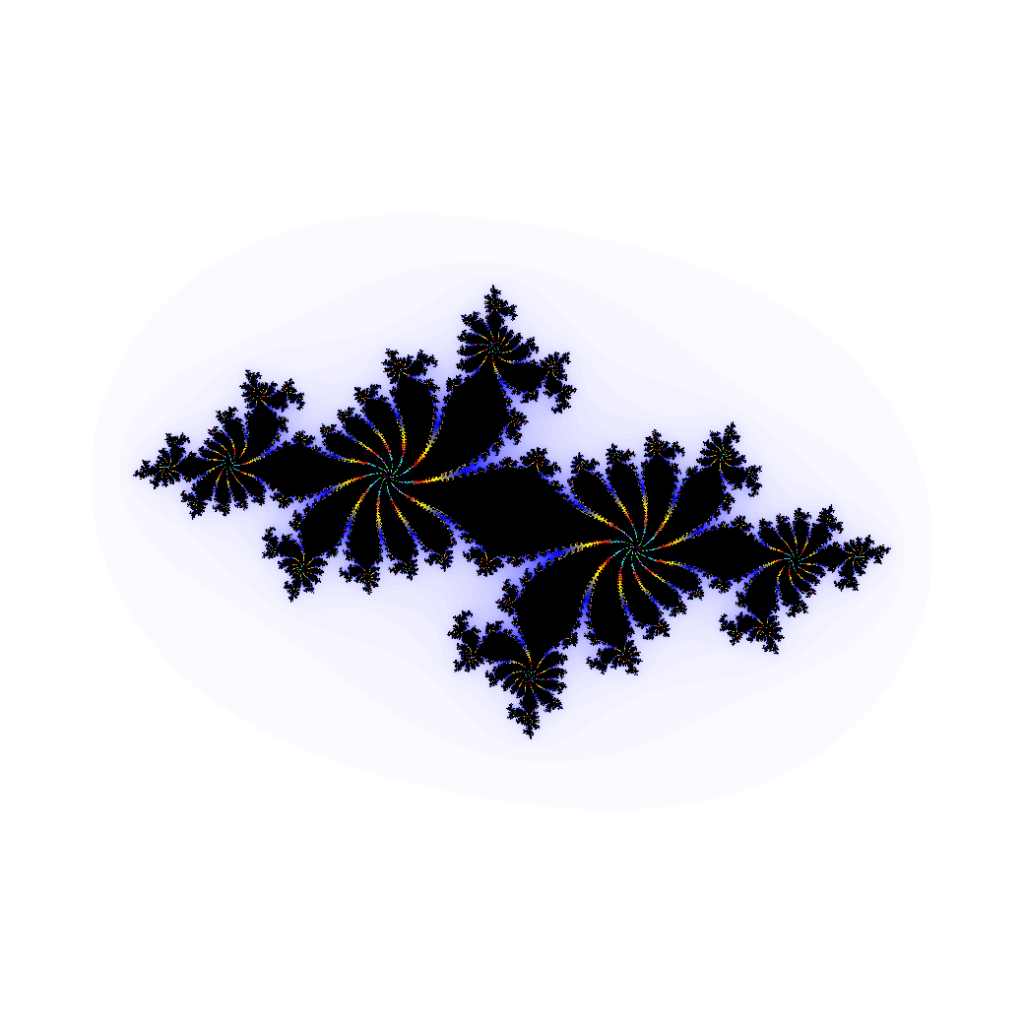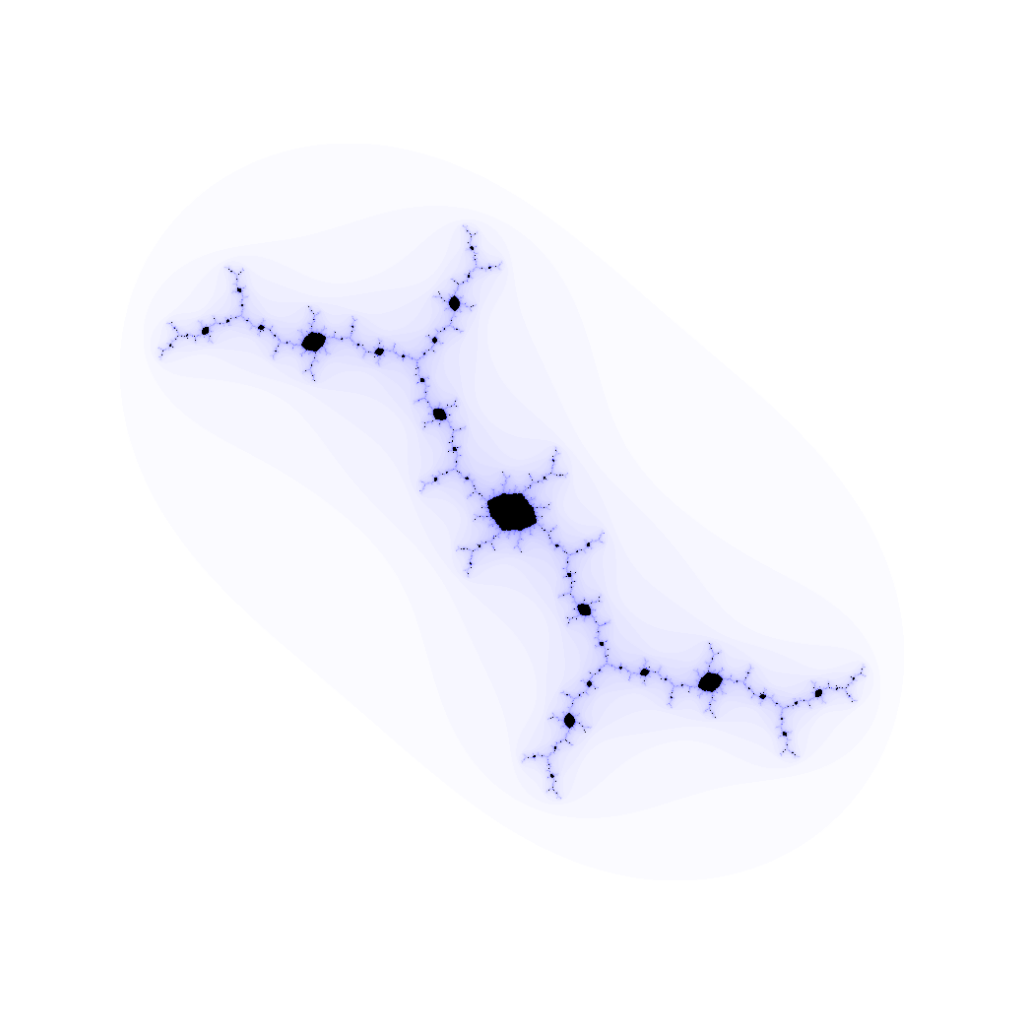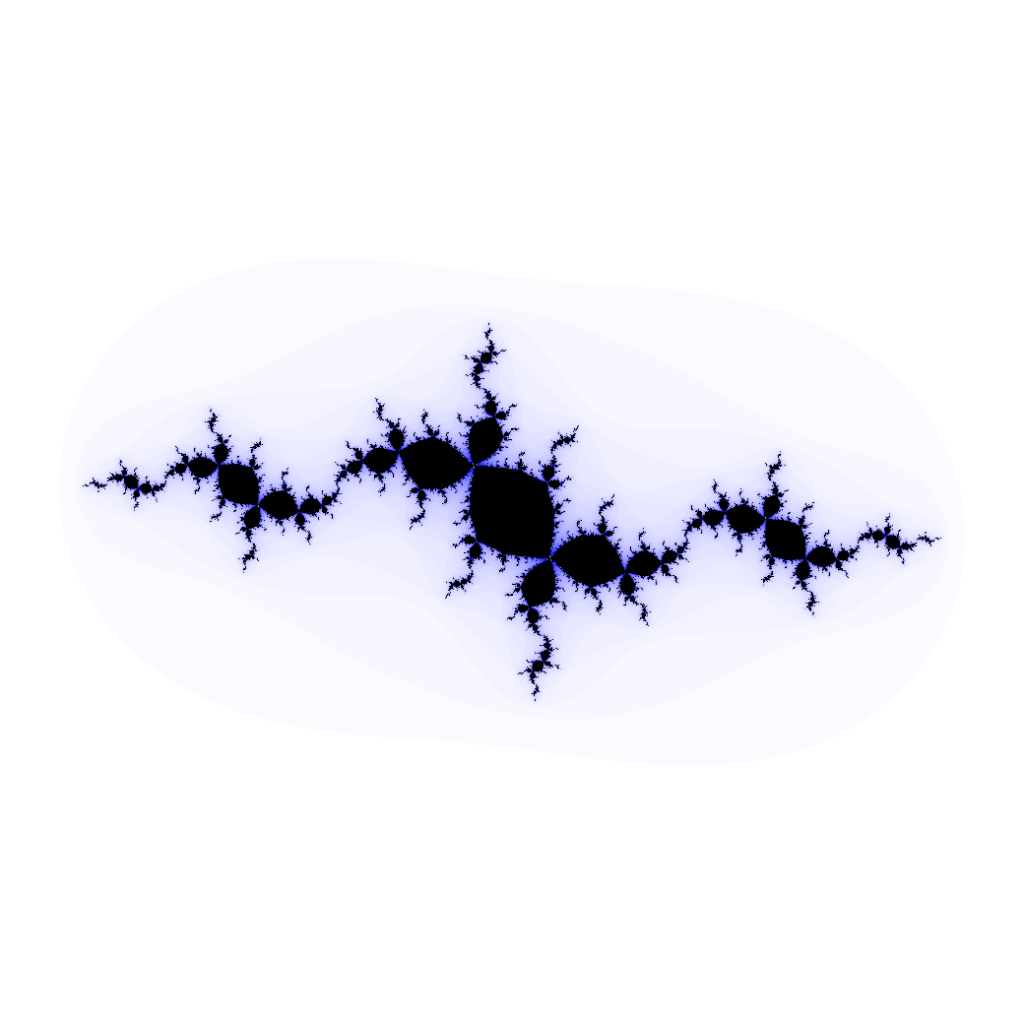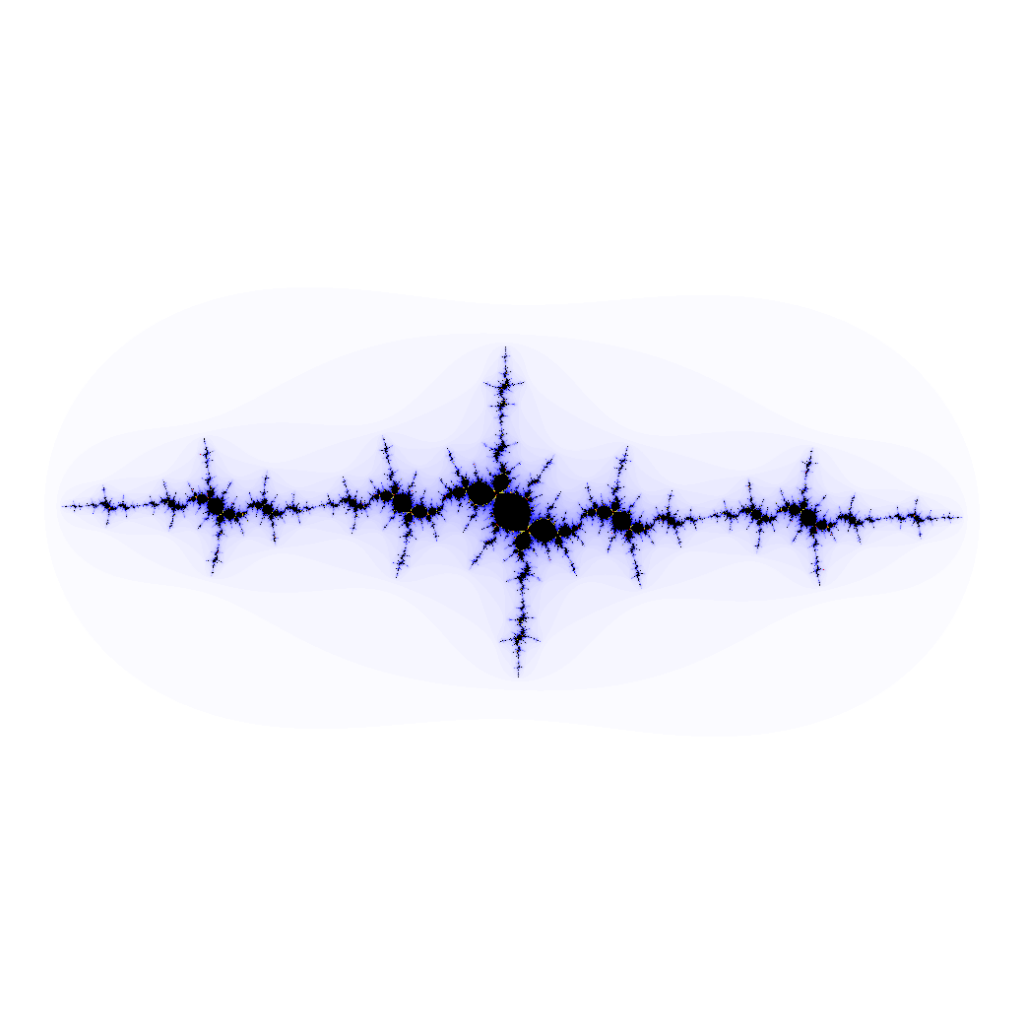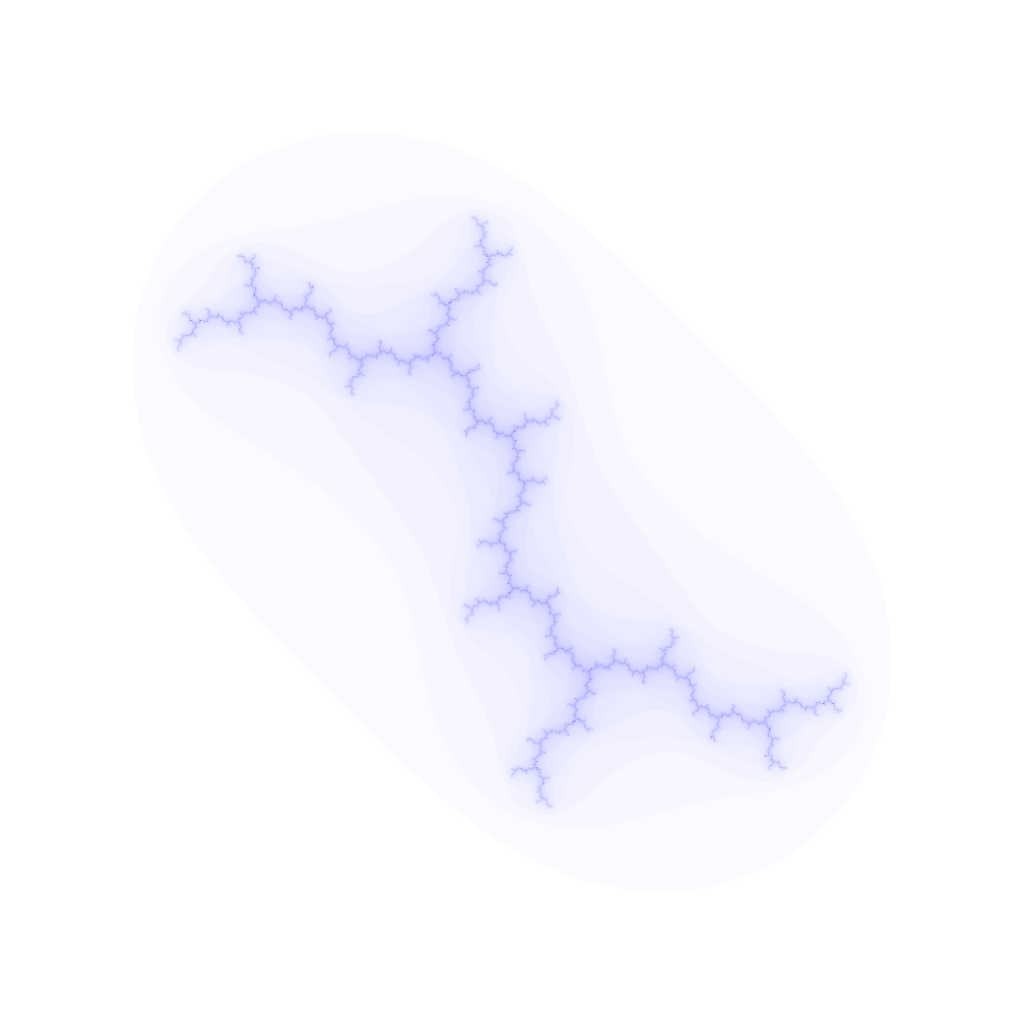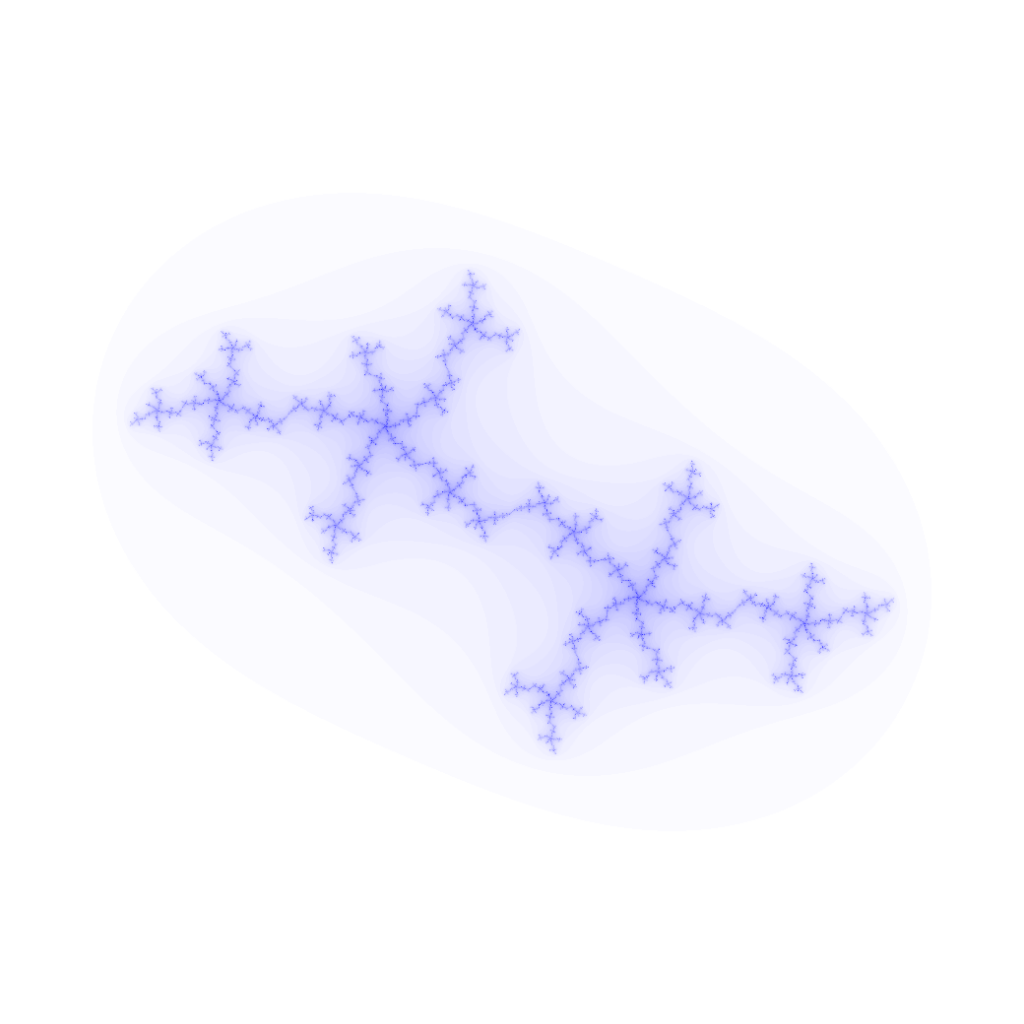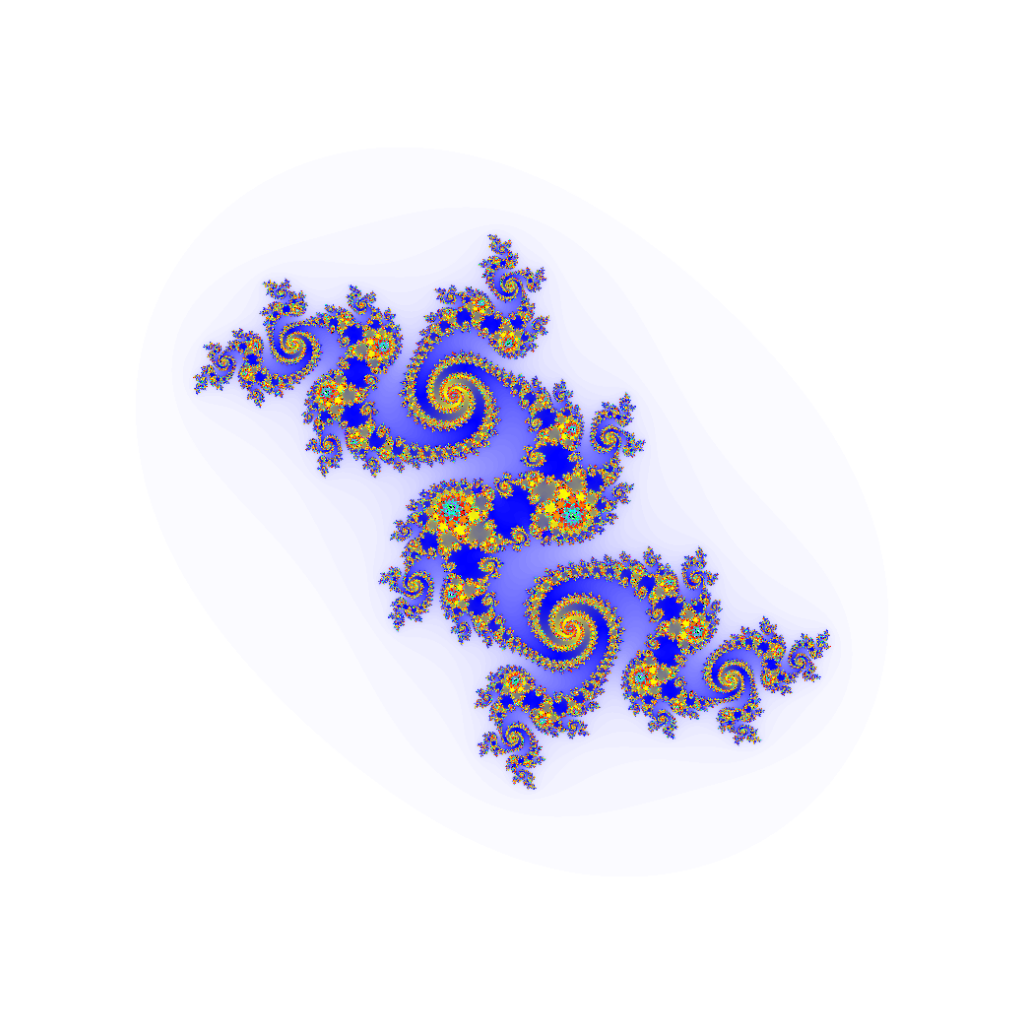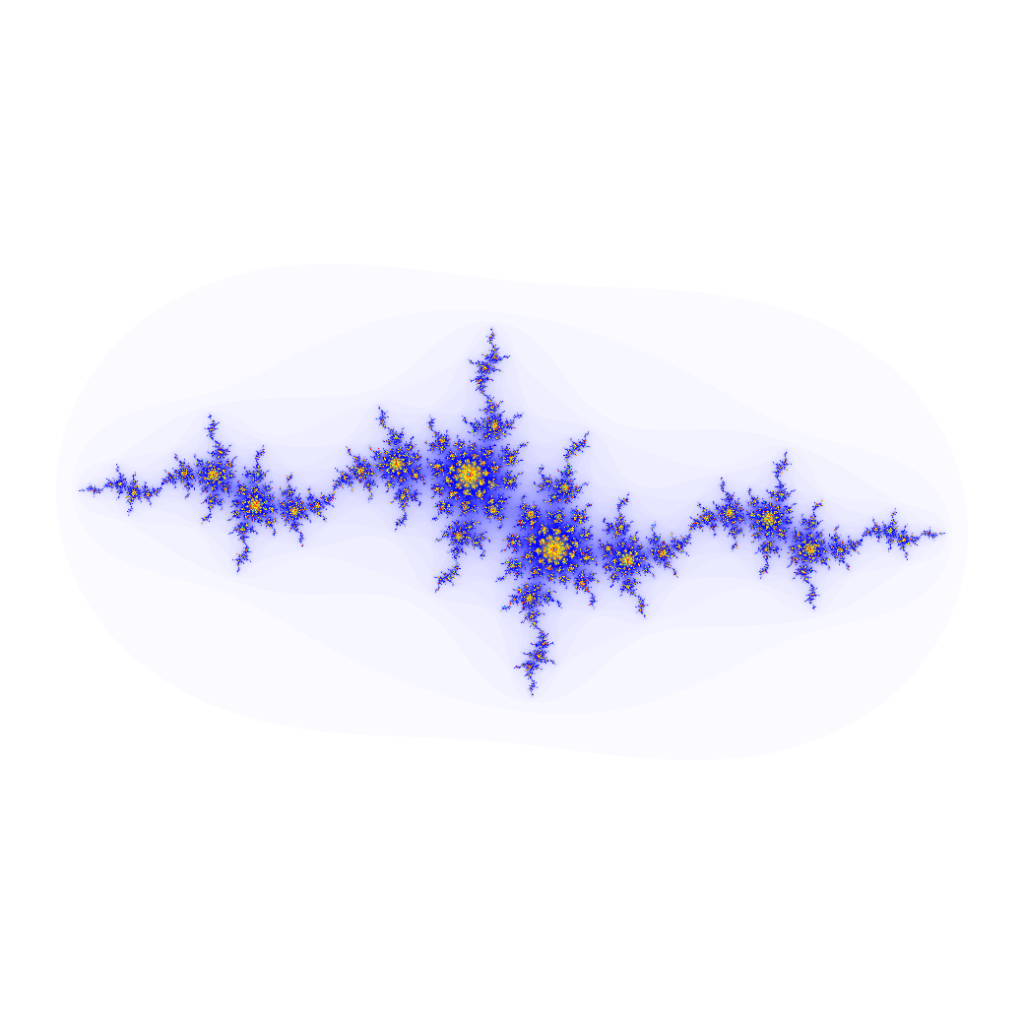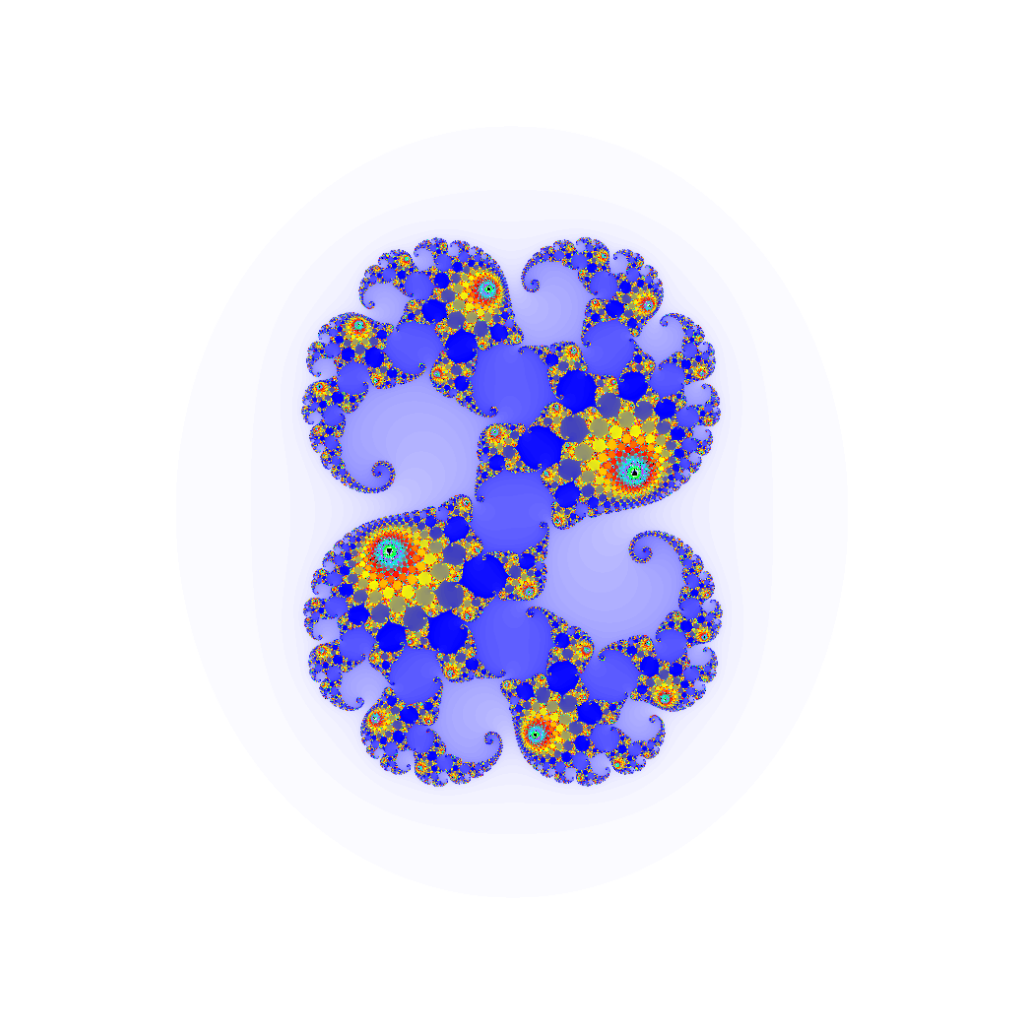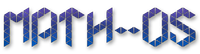Etant donné ![]() on considère pour tout
on considère pour tout ![]() la suite
la suite ![]() définie par :
définie par :
![]()
![]()
qui est une partie compacte et non vide de ![]() .
.
Un théorème de Fatou et Julia (1919) indique que ![]() est connexe ou totalement discontinu, selon la valeur de
est connexe ou totalement discontinu, selon la valeur de ![]() (voir illustrations en fin d’article).
(voir illustrations en fin d’article).
L’ensemble des ![]() pour lesquels
pour lesquels ![]() est connexe est l’ensemble de Mandelbrot, noté
est connexe est l’ensemble de Mandelbrot, noté ![]() :
:
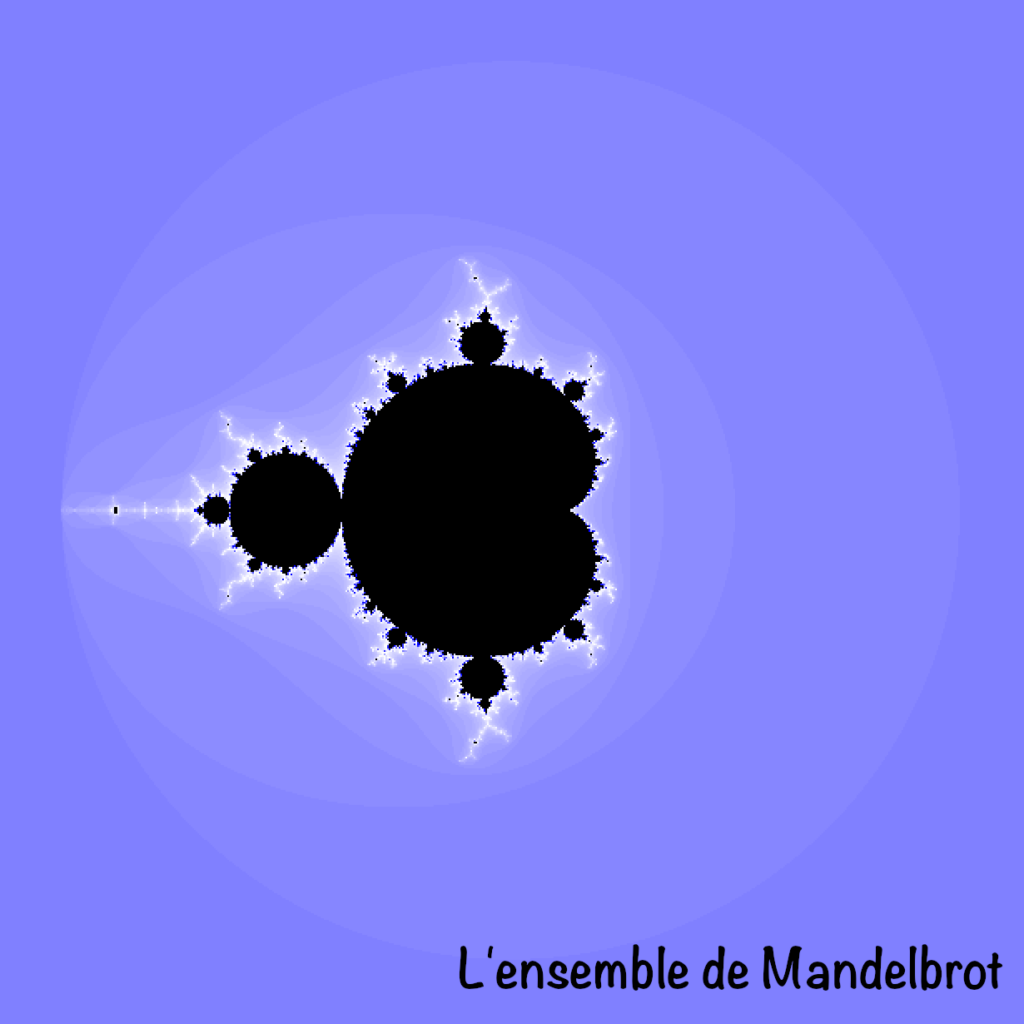
L’objet de cette note est de décrire ![]() dans deux cas particuliers très simples (les seuls) :
dans deux cas particuliers très simples (les seuls) :
- pour

- pour

Le cas c = 0
Proposition
![]() est le disque unité fermé.
est le disque unité fermé.
Lorsque ![]() la suite
la suite ![]() est définie par :
est définie par :
![]()
Attention : il s’agit de ![]() et pas de
et pas de ![]() …
…
A chaque étape de l’itération, le module est élevé au carré et l’argument est doublé.
➡ Si ![]() alors
alors ![]() ce qui prouve que
ce qui prouve que ![]() Donc :
Donc : ![]()
➡ Si ![]() alors la suite
alors la suite ![]() diverge en module vers
diverge en module vers ![]() puisqu’elle est extraite de la suite géométrique
puisqu’elle est extraite de la suite géométrique ![]() (qui possède ce comportement). Donc :
(qui possède ce comportement). Donc : ![]()
On peut visualiser ces comportements …
Pour ![]() on voit les premiers termes de la suite
on voit les premiers termes de la suite ![]() spiraler vers l’origine :
spiraler vers l’origine :
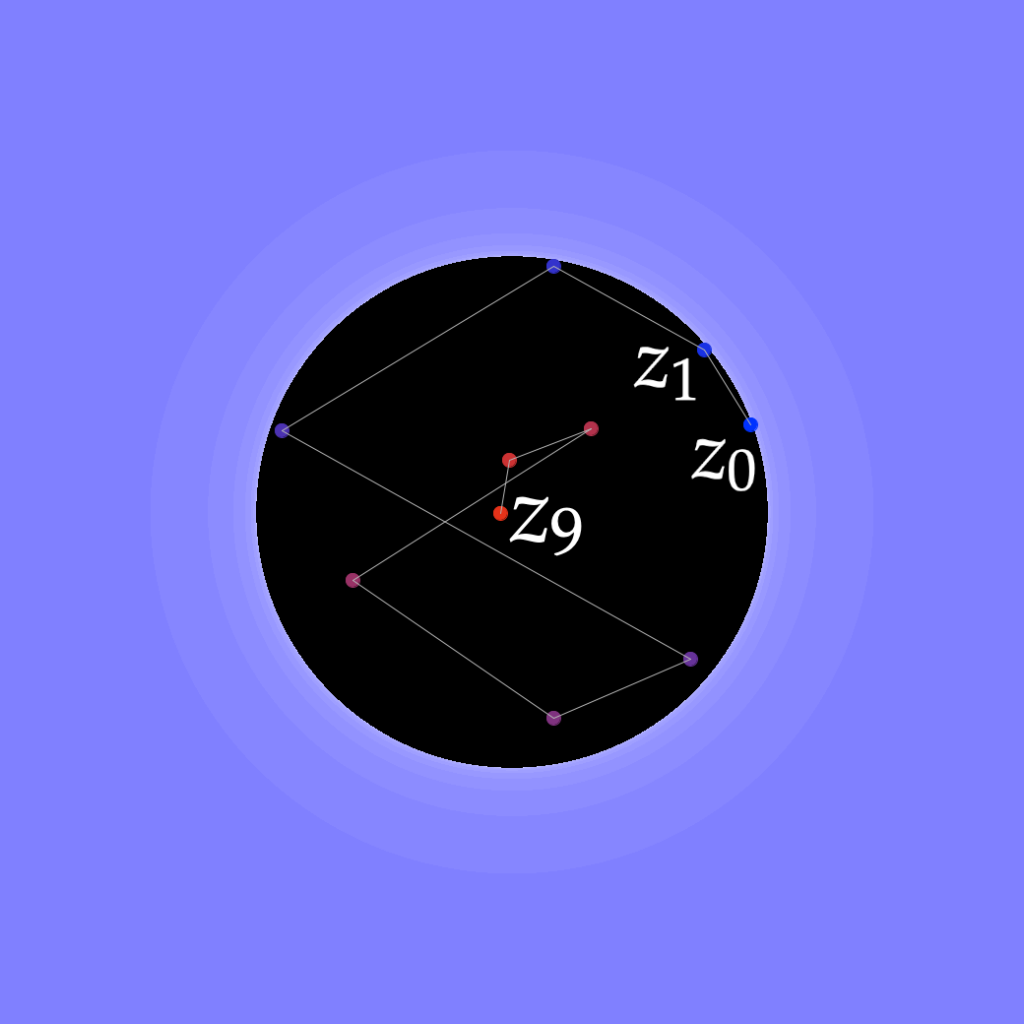
Pour ![]() la spirale se déroule à l’extérieur du disque unité :
la spirale se déroule à l’extérieur du disque unité :
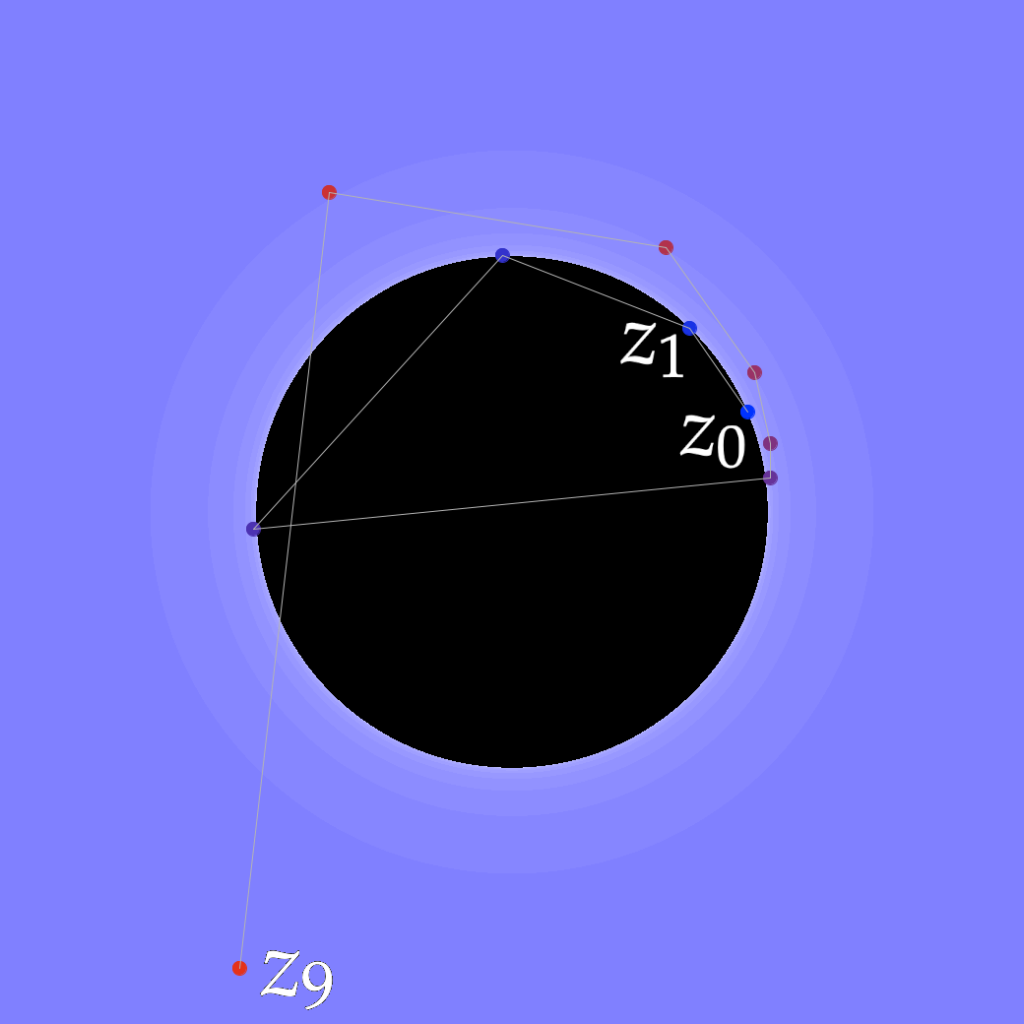
Bref :
![]()
Remarque
Il est frappant de constater que lorsque la suite ![]() diverge, elle diverge pour de bon ! Supposons par exemple que
diverge, elle diverge pour de bon ! Supposons par exemple que ![]() et calculons les modules des premiers termes :
et calculons les modules des premiers termes :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

Le cas c = -2
Lemme (Transformée de Joukowski)
Notons ![]()
Alors l’application ![]() est une bijection, qui « conjugue » les applications
est une bijection, qui « conjugue » les applications ![]() et
et ![]()
Notons ![]()
Pour tout ![]() si
si ![]() alors il existe
alors il existe ![]() tel que :
tel que :
![]()
On peut donc bien définir une application
![Rendered by QuickLaTeX.com \[\boxed{J:\Delta\rightarrow\mathbb{C}-\left[-2,2\right],\thinspace z\mapsto z+\dfrac{1}{z}}\]](https://math-os.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-6cb2267fbd791b82077799472e36d851_l3.png)
![]()
Ainsi :
![]()
Enfin, pour tout ![]() :
:
![]()
![]()
![]()
![]()
Proposition
![]() est le segment réel
est le segment réel ![]()
Si ![]() alors il existe
alors il existe ![]() tel que
tel que ![]() d’où :
d’où :
![]()
![]()
Par ailleurs, si ![]() le lemme montre qu’il existe (un unique)
le lemme montre qu’il existe (un unique) ![]() tel que
tel que ![]() Alors :
Alors :
![]()
![]()
Finalement :
![]()
A quoi ressemblent les autres ensembles de Julia ?
Lorsque ![]() prend d’autres valeurs, l’ensemble
prend d’autres valeurs, l’ensemble ![]() possède une structure infiniment plus riche et plus difficile à décrire … Lorsqu’on zoome sur sa frontière, on voit essentiellement le même paysage, peu importe l’échelle. Pour cette raison, on parle d’ensemble « fractal » :
possède une structure infiniment plus riche et plus difficile à décrire … Lorsqu’on zoome sur sa frontière, on voit essentiellement le même paysage, peu importe l’échelle. Pour cette raison, on parle d’ensemble « fractal » :
Ci-dessous, sont représentés quelques ensembles de Julia remplis, pour diverses valeurs du paramètre ![]() Les 7 premiers sont connexes. Les 2 suivants aussi, mais de mesure nulle. Les 3 derniers sont totalement discontinus. Pour ces 5 dernières illustrations, on ne « voit » pas véritablement
Les 7 premiers sont connexes. Les 2 suivants aussi, mais de mesure nulle. Les 3 derniers sont totalement discontinus. Pour ces 5 dernières illustrations, on ne « voit » pas véritablement ![]() (aucun pixel noir sur l’image), mais on devine sa présence au fond d’une vallée …
(aucun pixel noir sur l’image), mais on devine sa présence au fond d’une vallée …